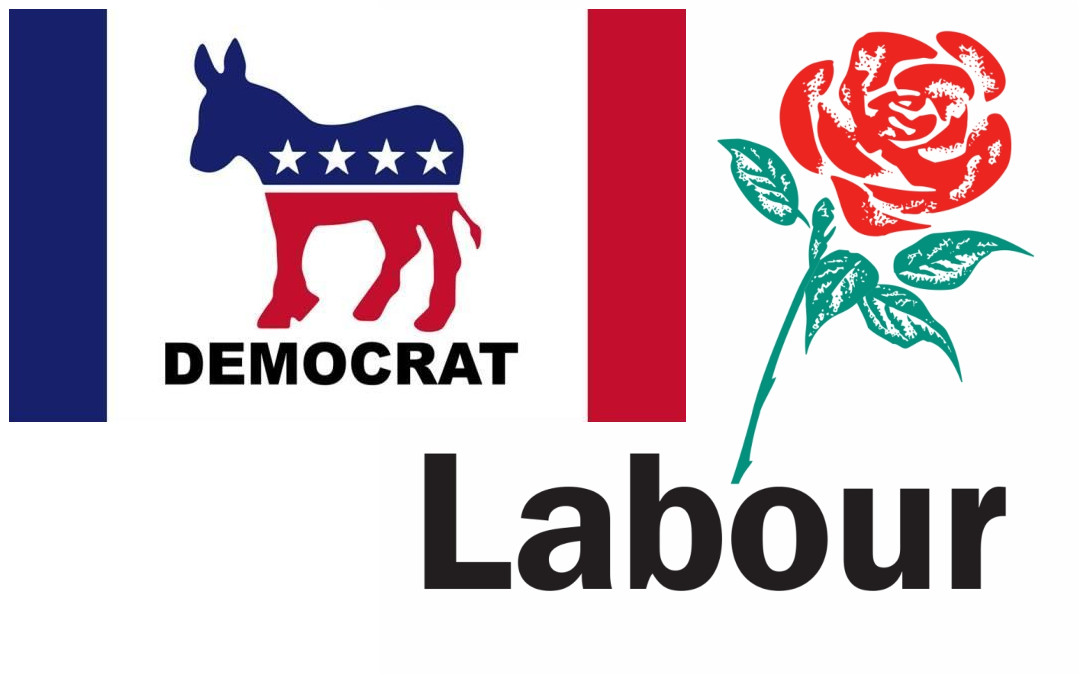Le renoncement de Bernie Sanders à la primaire démocrate ainsi que le retour du parti travailliste à une ligne plus centriste sont des nouvelles terribles pour toutes celles et ceux qui voyaient la possibilité de mettre un terme au néolibéralisme. Ce double échec nous interroge sur la pertinence d’un renouveau social-démocrate dans la recherche d’une alternative au néolibéralisme.
Deux événements politiques se sont déroulés quasi simultanément : le remplacement de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste britannique et l’abandon de Bernie Sanders dans la primaire démocrate. Il s’agit de tristes nouvelles qui ont douché plusieurs années d’espoir des gauches anglo-saxonnes.
Après la politique au centre, l’heure des ruptures
Pendant des années, il était convenu de dire qu’une élection se gagnait au centre : dans une bataille électorale entre une gauche et une droite, il s’agissait de s’adresser prioritairement au centre pour convaincre les indécis. Ce principe a conduit pendant des années à des alternances de gouvernements de centre-droit et de centre-gauche dont les politiques étaient tellement proches qu’elles en venaient à être vues comme une seule et même politique, induisant une désadhésion croissante de l’électorat à l’égard du vote lui-même.
Dans ces deux pays, la droite de l’échiquier politique a basculé dans le national-populisme. En Grande-Bretagne, le débat politique a été polarisé par la question de l’Union européenne avec à la clé la décision de quitter celle-ci lors du référendum du 23 juin 2016. La majorité du parti conservateur a alors basculé d’une ligne pro-Union européenne à une ligne de Brexit dur incarnée par Boris Johnson. Aux Etats-Unis, le parti républicain a désigné comme candidat aux présidentielles de 2016, Donald Trump, dont le slogan est « America First ».
Si cela a été compris à droite, la gauche a commencé à prendre le tournant de la rupture. La victoire de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste en 2015, et l’émergence d’un courant qui se définit comme socialiste au sein du parti démocrate en sont les signes précurseurs. Hélas, ce mouvement à gauche vient d’être interrompu aussi bien dans le parti travailliste que dans le parti démocrate. Si nous ne pouvons qu’espérer que cela ne soit que provisoire, il faut aussi s’interroger sur la rupture politique qui a été proposée par la gauche. A-t-elle été à la hauteur des enjeux ?
Le mouvement au centre qui a été pratiqué des années 1980 à la première décennie des années 2000 ne peut être réduit à un simple déplacement géométrique. Il s’est fait sur la base de l’adhésion aux principes du néolibéralisme, à savoir une rupture avec le cours antérieur du capitalisme, souvent qualifié de fordiste-keynésien. L’explication profonde de ce nouveau cours est le ralentissement de la croissance qui n’autorisait plus le même rapport entre les classes pour permettre la valorisation du capital. Ce recentrage de la vie politique traduisait dans la réalité une droitisation du centre.
Une rupture social-démocrate est elle possible ?
Les deux gauches britannique et étasunienne ont eu une orientation délicieusement rétro : il s’agissait essentiellement de restaurer l’État social instauré pendant le New Deal aux États-Unis et dans l’immédiat après-guerre au Royaume-Uni, tout en laissant la majeure partie de l’économie dans les mains des sociétés de capitaux. Il s’agit d’utiliser l’État comme antidote à l’irrationalité des marchés, comme un outil permettant de produire du commun. Leurs programmes comportent deux volets essentiel : une fiscalité progressive permettant de réduire les inégalités criantes et de plus en plus insupportables et une intervention directe de l’État dans la vie économique par la mise en place ou le renforcement de services publics, l’accent était mis sur la santé publique dans le cas des États-Unis et sur le secteur ferroviaire dans celui du Royaume-Uni.
Hélas, une configuration du capitalisme à un moment donné ne peut guère se reproduire demain et la croissance en est la raison principale. A l’époque, celle-ci était possible du fait des technologies existantes qui nécessitaient des investissements gigantesques. La période des Trente glorieuses a été marquée par l’émergence de l’automobile et des loisirs, d’une augmentation sans précédent de la richesse due à des rendements agricoles sans commune mesure avec le passé. Nous savons maintenant qu’une grande partie de ces évolutions ont été réalisées au mépris de notre environnement ; nous savons que, sur de nombreux points, nous devons faire machine arrière ou tout au moins, ne pas persévérer dans la voie d’une croissance aveugle et infinie. Mais une chose reste évidente : dans ce contexte, il était possible de taxer lourdement le capital, de maintenir hors-marché de larges secteurs de l’économie. Des revenus très limités du capital par rapport à la production n’interdisaient pas une valorisation conséquente de celui-ci par le simple fait que les dividendes étaient appelés à grossir année après année sans changer le rapport entre les classes.
Plus rien de tel aujourd’hui et c’est ce qu’a compris très tôt le néolibéralisme. Il fallait modifier radicalement le rapport entre les classes, réaliser une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, et ouvrir le maximum de marchés au capital, d’où le phénomène de démantèlement des services publics et de privatisation de l’immatériel et du vivant. Vouloir revenir au passé relève dès lors de la gageure. En ayant comme programme, non pas un réel programme de transformation sociale mais un simple un retour à une situation passée, est-ce que ces gauches ne continuent pas à jouer au centre, alors que celui-ci n’est plus de mise ?
Les nationaux-populistes ont réussi à donner l’illusion de la rupture tout en se maintenant dans le droit fil du néolibéralisme. Face à la misère sociale que génère celui-ci, leur stratégie consiste à diviser les classes populaires par un nationalisme anti-étranger. Il s’agit de muscler le discours de l’État concernant l’évaluation des réciprocités de marché entre pays et de désigner les migrants et les étrangers en général comme étant les facteurs de baisse du coût du travail. Le négationnisme climatique est souvent de mise vis-à-vis de politiques environnementales accusées d’être des entraves au travail. Ce national populisme se présente toujours sous un discours autoritaire mais l’autoritarisme n’est désormais plus le monopole de celui-ci et on peut réellement se demander si celui-ci n’est pas la caractéristique désormais commune du néolibéralisme, évolution ultime d’un capitalisme en panne de croissance. Est-ce que la véritable rupture avec l’ordre existant ne serait pas plutôt la revendication d’une démocratie totale, une démocratie pleine et entière à opposer autant au populisme de droite qu’à l’autoritarisme de plus en plus marqué des « démocraties libérales » ?
Une rupture pour une démocratie pleine et entière
Commençons par recenser nos aspirations en cette période de Covid-19. Celle qui revient en boucle est la baisse immédiate de la pollution qui ouvre l’espoir fabuleux d’une autre vie, d’une vie où l’on produirait moins, où on aurait plus de temps libre pour soi et les autres, une économie qui respecterait notre planète et assurera un avenir à notre humanité. Une chose reste certaine : ce n’est pas en laissant le pouvoir économique dans les mains d’actionnaires préoccupés par la valorisation de leur capital et donc des perspectives de croissance que cela sera possible. Cela ne le sera que si les salarié.es co-dirigent demain les unités de production pour déterminer quoi produire et comment distribuer cette production. Ceci permettra de répondre à une autre aspiration qui émerge : le rejet de l’autoritarisme au travail et le désir d’être écouté et de réaliser une production que l’on juge utile.
Une autre aspiration porte sur la stabilité des revenus et le fait que plus personne ne soit en situation d’exclusion. Cet aspect est essentiel dans une perspective de transformation écologique de nos économies : si certains secteurs économiques sont appelés à se créer ou à croître, d’autres en revanche vont disparaître. Il va donc falloir engager des transitions professionnelles et faire face à des disparitions d’emplois. Dans le même esprit, de nombreuses personnes ne supportent plus d’être marginalisées, sans emploi ou enchaînant petits boulots sur petits boulots mal payés. Comment rompre avec ceci ? Pour le capitalisme, la force de travail est une marchandise et toute solidarité collective qui renchérit son coût est à proscrire. C’est ce qui explique l’impossibilité de penser une garantie d’emploi et de revenu ou toute forme de sécurité sociale professionnelle un peu sérieuse. À l’inverse, si les travailleur.ses sont au pouvoir dans l’unité de production, il peut alors y avoir une délibération collective sur la mutualisation du revenu entre les unités productives, sur la façon de partager les revenus et le travail entre les individus de façon à ce que plus personne ne soit laissé pour compte ou soit réduit à accepter des minimums sociaux.
On comprend qu’une telle politique puisse être taxée d’ultra-radicale parce qu’elle postule le pouvoir des travailleur.ses et des usagers dans les unités de production et donc l’éviction des actionnaires. On pourrait donc penser qu’une telle visée serait électoralement plus minoritaire qu’un programme social-démocrate. Ceci reste à démontrer.
Construire une majorité
En effet, le pouvoir des travailleur.ses et des usagers dans les unités de production est la condition sine qua non pour qu’une véritable démocratie puisse exister. Plutôt que de réaliser des programmes de gouvernements ficelés de bout en bout, qui ne peuvent que provoquer des rejets et rétrécir une base électorale, s’annonce la possibilité de permettre à la population de débattre et de décider sur tous les sujets politiques. Quels secteurs de la vie économique voulons-nous mettre hors marché ? Si oui, selon quelles modalités et pour quel budget ? Comment voulons-nous partager les revenus entre les entreprises et à l’intérieur de chaque unité de production ?
La gauche se meurt de ses divisions parce qu’elle se donne pour vocation de gouverner dans le cadre étroit d’un gouvernement qui devra partager son pouvoir avec les détenteurs d’argent. Si son programme se concentre sur la démocratisation totale de la société à commencer par celle des entreprises, en laissant ouverte toutes les questions relatives aux modalités de la transition écologique, au partage des revenus, aux investissements à réaliser et aux secteurs à placer hors marché, non parce qu’elle s’y désintéresse, bien au contraire, mais parce qu’elle estime que son rôle n’est pas d’être un parti guide mais de donner à la population les pleins moyens de décider, elle sera alors en mesure de réaliser une large alliance unissant des propositions contradictoires sur bien des sujets, mais des propositions qui n’auront jamais aucune chance de voir le jour dans le cadre du maintien du capitalisme.