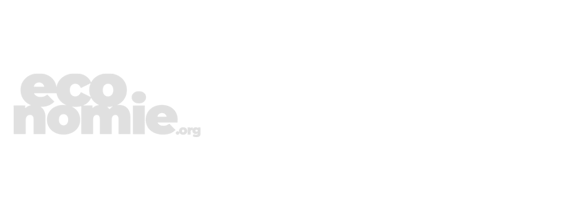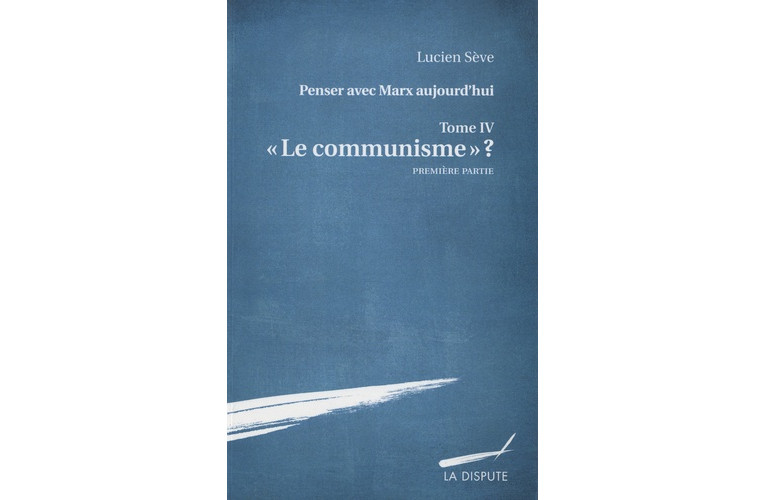Dans la première partie de Penser avec Marx aujourd’hui, Tome IV, « Le communisme » ?, Lucien Sève conteste le communisme des anciennes sociétés dites du « socialisme réel ». Il nous démontre en quoi celles-ci tournent fondamentalement le dos au communisme marxien autant dans la théorie que dans la réalité historique.
Mais qu’y a-t-il donc de commun entre le communisme explicité par Marx au XIXe siècle et le « communisme » de l’Union soviétique ? La réponse est évidente : rien. Le communisme de Marx se présentait comme la société qui pouvait et devait succéder au capitalisme et que ce dernier définissait par l’absence de classe sociale. L’exploitation – une partie de la production réalisée par le prolétariat est accaparée par la bourgeoisie – et l’aliénation – le producteur n’est pas maître de sa production car ce processus lui échappe et est dicté par les propriétaires – devaient alors disparaître. Dans le communisme, les producteurs s’approprient les moyens de production en contrôlant ceux-ci, ce qui devait ouvrir la voie au dépérissement de l’État. Or, dans les pays du « socialisme réel », l’État n’a jamais cessé d’être omniprésent et faute d’appropriation de la production par les travailleurs eux-mêmes, il ne montrait aucun signe tangible de dépérissement.
Pour les thuriféraires du capitalisme et du libéralisme, le vers était dans le fruit : les écrits de Marx ne sont que des visées idéalistes qui ne pouvaient aboutir qu’au totalitarisme que nous avons connu. Dans son dernier livre, Penser avec Marx aujourd’hui, Tome IV, « Le communisme » ?, première partie, Lucien Sève nous emmène dans un parcours théorique et historique pour nous montrer que la démarche de Marx constitue au contraire une rupture matérialiste avec les socialismes utopiques et les communismes primitifs du début du XIXe siècle, que pour celui-ci, le communisme ne peut exister qu’en fonction d’un certain niveau de développement des forces productives, entendons par là un niveau de productivité et d’éducation des producteurs. Comme Lénine l’avait pressenti, ces conditions était loin d’être réunies en Russie et expliquent le tournant de la NEP (Nouvelle politique économique) en 1921 après la guerre civile : il s’agissait d’admettre que le communisme n’était pas pour tout de suite, ce qui explique un développement des marchés agricoles basé sur la petite propriété associé à un début d’industrialisation dans une combinaison mixte État marché. La rupture avec la vision marxienne du communisme se réalise donc par la prise de pouvoir de Staline et cette fin prématurée de la NEP au profit d’un volontarisme économique d’une criminalité inouïe de la part d’un État omniprésent et totalitaire.
Dans le premier chapitre, Lucien Sève aborde toute une série de questions telles que la différence initiale entre socialisme et communisme, la transformation qu’opère Marx sur la notion de communisme par l’élaboration du matérialisme historique et sa définition de l’aliénation à travers trois ouvrages majeurs : La sainte famille, les manuscrits de 1844 et L’idéologie allemande. C’est dans ce cadre intellectuel que se forge la notion de développement des forces productives, condition sine qua non de la possibilité du communisme, et de son articulation avec la lutte des classes. La définition du communisme comme société sans classes s’appuie sur l’abolition de la propriété privée qui « n’est pas du tout celles des moyens individuels de l’existence personnelle, ce que ne réduirait en rien l’aliénation de tous et de chacun, mais celle des moyens sociaux de production et d’échange – c’est cela seulement qui fera révolution dans l’histoire humaine. » (p. 121).
Marx et Engels participent et assistent aux révolutions européennes de 1848 et à leur écrasement dans le sang. C’est ce qui les amènera à défendre le recours à la violence, non comme principe général mais comme « éventuel recours à la terreur révolutionnaire [qui] ne s’impose que comme contre-terreur lorsque se l’interdire équivaudrait à un défaitisme consenti. » (p. 169). Voilà qui contredit à jamais l’idée que le communisme serait intrinsèquement « criminogène » comme l’indique Stéphane Courtois1)Stéphane Courtois et allii, Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répressions, Robert Laffont, 1997, p. 812.. Toujours avec la même méthode, Lucien Sève nous décrit les évolutions de Marx et d’Engels dans les années 1850 sur la nécessité de commencer un long travail de construction en profondeur d’un mouvement politique car les conditions ne sont pas mûres pour un communisme immédiat. L’auteur nous rappellera les divergences profondes entre la visée communiste et le socialisme lassallien allemand sur la question de l’État. Ce dernier aura une influence déterminante dans la social-démocratie allemande et peut expliquer en partie son ralliement à la guerre en 1914. À l’inverse, Lucien Sève interroge la possibilité d’un usage révolutionnaire de la réforme avec Jaurès.
Face aux critiques qui sont faites à Marx de ne pas avoir décrit ce que serait le communisme, Lucien Sève nous emmène dans une lecture approfondie de textes plus tardifs et notamment du Capital, pour nous montrer que cette visée était, au contraire et autant que faire se peut, assez précise. Il en conclut à la définition d’un « communisme individuelliste » de Marx. Face à « la liberté d’un individu sans prise sur l’essentiel dans une société plus que jamais immaîtrisable » (p.278), Lucien Sève réaffirme qu’« aller au communisme, c’est bien plus que sortir du capitalisme, c’est renvoyer décisivement au passé cette sorte encore incivilisée de civilisation qu’impose toute société de classes. » Il note un « saisissant déplacement » de Marx dans les textes de 1860 dans lesquels le développement universel des individus est passé au tout premier plan : « Si le rôle à reconnaître aux moyens de production […] n’est en rien minoré, ce qui a été majoré dans sa pensée est l’importance de l’individualité humaine » (p. 279). Il conclut ce chapitre en revenant sur la controverse des deux « phases » de l’édification communiste l’une « inférieure » l’autre « supérieure » abusivement interprétée par beaucoup comme étant le socialisme préalable au communisme, ce socialisme se caractérisant par un renforcement de l’État.
Le second chapitre a pour titre « communisme et « communisme » dans le court XXe siècle » et démonte cette escroquerie intellectuelle qui consiste à dénommer « communisme » ce qu’on été les sociétés du « socialisme réel ». Plutôt que de décrire les atrocités du stalinisme, ce qui a déjà été fait dans le passé et n’a pas à être minoré, Lucien Sève s’attache ici à démontrer les multiples ruptures du stalinisme avec le marxisme. Il nous montrera en quoi la déstalinisation de Khrouchtchev n’a été que superficielle, se contentant de dénoncer ses aspects les plus tragiques sans en remettre en cause les fondements. Ce chapitre est l’occasion de passer en revue, à la lumière de cette analyse, les multiples expériences socialistes du XXe siècle (la Yougoslavie, la Chine de Mao, le cours nouveau de Deng Xiao Ping, Cuba), la dissidence marxiste de Rudolf Bahro en RDA et l’échec gorbatchévien, avant de souligner le contenu communiste qui a néanmoins existé dans le mouvement « communiste » international lorsque ces partis ne dirigaient pas la société. C’est ainsi qu’il soulignera l’importance de l’apport théorique de Gramsci et les innovations que le PCF a su apporter à la Libération : l’établissement de la sécurité sociale et le statut de la fonction publique.
S’il s’agit ici d’un ouvrage imposant (670 pages), ce livre se lit d’une traite car il articule les éléments qui permettent de comprendre comment la visée marxienne a pu être confondue avec les sociétés totalitaires qui s’en réclamaient. Le propos de Lucien Sève est clair : le communisme reste d’actualité. C’est sans doute ce qu’il va démontrer dans la deuxième partie de cet ouvrage à paraître qui comportera le troisième chapitre sur le XXIe siècle. Il n’en reste pas moins vrai que trois questions fondamentales méritent d’être posées :
Si le communisme ne peut se réaliser que dans le cadre d’un haut développement des forces productives, est-ce que cela n’aurait pas déjà été possible au XXe siècle ? La révolution espagnole de 1936 n’en serait-elle pas une illustration ? Le communisme n’aurait-il pas pu être possible au XXe siècle sans l’existence de ce repoussoir du « communisme » ? Question bien sûr impossible à trancher, mais les dernières évolutions d’un capitalisme de plus en plus brutal et incapable de répondre aux enjeux climatiques et civilisationnels nous montrent que les conditions d’un passage au communisme sont désormais mûres, pour ne pas dire trop mûres, en Europe occidentale.
Si la désaliénation du travail est une composante essentielle de la visée communiste, est-ce que cet élément n’a pas été escamoté par une appropriation sociale pensée par la nationalisation des moyens de production, dans laquelle le travail est toujours subordonné, question que je pose dans Au-delà de la propriété, pour une économie des communs, Éditions La Découverte ? Si ce mode d’appropriation sociale a été de facto questionné par Marx dans le Tome III du Capital et La guerre civile en France, Engels (dasn Anti-Dühring), puis Lénine (dans L’État et la révolution) refermeront le débat. Jaurès esquissera puis les communistes yougoslaves tenteront, dans la pratique, de tracer une évolution de la propriété étatique des moyens de production vers une propriété sociale mais ce chemin s’est avéré piégé par la notion même de propriété.
Si Lucien Sève a correctement reprécisé en quoi consistait la visée communiste, est-il encore entendable d’appeler communisme le dépassement du capitalisme, tant ce terme a été détourné dans le passé ? Il est vrai que dans un précédent livre co-écrit avec son fils Jean2)Jean et Lucien Sève, Capitalexit ou catastrophe, Entretiens, La Dispute, 2018, Lucien Sève parle de Capitalexit.
Lucien Sève
Penser avec Marx aujourd’hui : Tome 4, « Le communisme » ? Première partie
La Dispute, 2019
ISBN 9-782843-033049
670 pages
40 euros
References
| 1. | ↑ | Stéphane Courtois et allii, Le livre noir du communisme, Crimes, terreur, répressions, Robert Laffont, 1997, p. 812. |
| 2. | ↑ | Jean et Lucien Sève, Capitalexit ou catastrophe, Entretiens, La Dispute, 2018 |